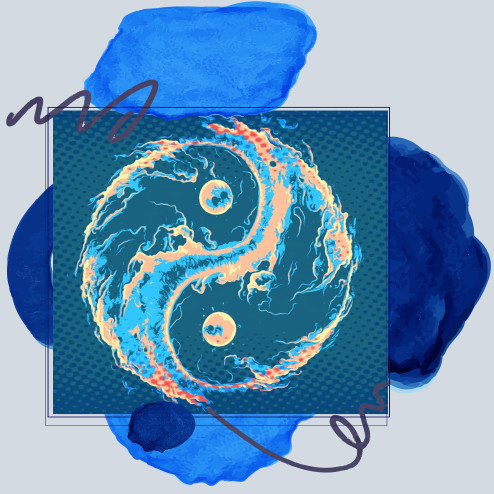
Dans l'histoire des idées religieuses le dualisme offre une vision du monde clivée, où deux forces ou principes fondamentaux s'affrontent pour façonner la réalité. De la Perse antique au Languedoc médiéval, en passant par les Balkans, ce concept a pris des formes variées, laissant une empreinte indélébile sur la pensée spirituelle.
Tout commence en Perse, au VIe siècle avant notre ère, avec l'émergence du zoroastrisme, fondé par le prophète Zarathoustra (ou Zoroastre). Cette religion novatrice introduisit une conception du cosmos structurée autour de l'opposition entre Ahura Mazda (Ormazd), le dieu bon, source de toute lumière, vérité et ordre, et Angra Mainyu (Ahriman), l'esprit destructeur, instigateur des ténèbres, du mensonge et du chaos.
Si ce dualisme n'impliquait pas toujours une égalité parfaite entre les deux entités, Ahura Mazda étant souvent perçu comme ultimement supérieur, il posait les fondations d'une lutte cosmique où l'humanité jouait un rôle crucial. Dotés du libre arbitre, les individus étaient appelés à choisir leur camp par leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Des concepts clés comme le jugement dernier, le paradis et l'enfer, si familiers dans les religions abrahamiques, trouvent ici leurs racines. Le zoroastrisme a ainsi légué au monde une structure de pensée où le bien et le mal ne sont pas de simples abstractions, mais des forces actives modelant l'existence.
Quelques siècles plus tard, au IIIe siècle après J.-C., un nouveau prophète, Mani, vit le jour et fonda le manichéisme. Cette religion syncrétique, puisant dans le zoroastrisme, le christianisme et les courants gnostiques, radicalisa le concept dualiste. Pour les manichéens, le cosmos était le théâtre d'une lutte primordiale entre deux royaumes éternels et indépendants : le Royaume de la Lumière (le domaine du bien, de l'esprit) et le Royaume des Ténèbres (celui du mal, de la matière).
La création du monde actuel était perçue comme une tragédie, le résultat d'une intrusion des Ténèbres dans le Royaume de la Lumière, emprisonnant des parcelles de lumière divine au sein de la matière impure. Le but de la vie humaine devenait alors la libération de ces étincelles lumineuses et leur retour à leur source spirituelle. Le manichéisme connut une expansion fulgurante, s'étendant de l'Empire romain jusqu'en Chine, séduisant des penseurs comme le jeune Augustin avant sa conversion au christianisme. Son dualisme radical et sa vision cosmique ont durablement marqué l'histoire des idées religieuses, même après son déclin en tant que religion organisée.
Au Xe siècle, dans les Balkans, une nouvelle expression du dualisme émergea au sein du christianisme : le bogomilisme. Bien qu'ancré dans la tradition chrétienne, ce mouvement développa une cosmologie dualiste distincte. Les bogomiles croyaient en l'existence de deux principes : un bon Dieu, créateur du monde spirituel et de l'âme humaine, et un mauvais Dieu (souvent identifié à Satan), responsable de la création du monde matériel et du corps, intrinsèquement perçu comme mauvais.
En conséquence de cette vision, les bogomiles rejetaient l'Ancien Testament, les sacrements de l'Église orthodoxe, le culte des saints et les icônes, considérant ces éléments comme appartenant au domaine du créateur maléfique. Leur influence se répandit dans les Balkans, nourrissant d'autres formes de dissidence religieuse et laissant des traces durables dans la culture de la région.
Ceal s'achève au XIIe siècle, en Occitanie et dans le nord de l'Italie, avec l'apparition du catharisme. Ce mouvement chrétien dualiste, bien que ses liens exacts avec le bogomilisme soient encore débattus par les historiens, partageait avec lui une vision du monde marquée par une opposition fondamentale entre le spirituel et le matériel.
Le catharisme se manifestait sous différentes formes de dualisme. Un dualisme absolu postulait l'existence de deux dieux égaux et éternels, l'un bon, créateur du spirituel, l'autre mauvais, à l'origine du matériel. Un dualisme mitigé considérait le dieu mauvais comme un ange déchu, subordonné au dieu bon. Quelle que soit leur nuance, les croyances cathares valorisaient le monde spirituel et prônaient un ascétisme rigoureux, rejetant le mariage charnel, la procréation, la consommation de viande et d'autres plaisirs terrestres vus comme des pièges du principe mauvais. Leur communauté était structurée autour des "Parfaits", une élite spirituelle ascétique, et des "croyants".
La floraison du catharisme en Occitanie fut perçue comme une menace par l'Église catholique, qui lança au XIIIe siècle la violente croisade des Albigeois pour éradiquer cette «hérésie». Malgré cette répression brutale, l'écho du dualisme cathare résonne encore aujourd'hui, témoignant d'une quête spirituelle alternative qui interrogeait la nature du bien et du mal et la valeur du monde matériel.
De la vision cosmique du zoroastrisme à l'ascétisme radical des cathares, l'histoire du dualisme religieux est un témoignage de la diversité des réponses humaines aux questions fondamentales sur l'existence. Bien que chaque mouvement ait ses spécificités et son contexte historique propre, un fil rouge les unit : la conviction d'une division intrinsèque de la réalité, d'une lutte constante entre des forces opposées. Cette histoire spirituelle binaire nous rappelle la complexité de l'histoire des idées et la persistance de certaines interrogations qui continuent de façonner notre compréhension du monde.
Pour aller plus loin :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme_(philosophie)
.